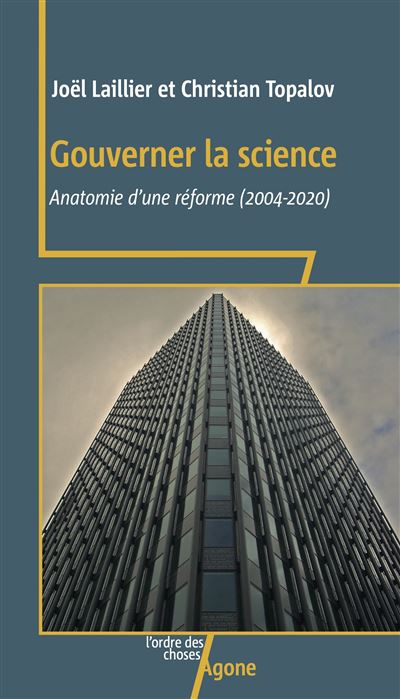
Joël LAILLIER, Christian TOPALOV
Gouverner la science , anatomie d’une réforme
Agone, 416 pages, 25€
Cinq questions à Joël Laillier et Christian Topalov
Propos recueillis par Guy Dreux
Dès les premières lignes vous précisez que ce livre est né d’une « colère », mais aussi d’un « trouble ». La colère est celle, largement partagée, qui s’exprime contre les réformes profondes de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR). Le « trouble » est celui de voir le monde de la recherche, le monde des chercheurs, prendre une part active à ces réformes alors même qu’elles affectent de nombreuses pratiques professionnelles.
Christian Topalov : L’origine de ce livre est militante, en effet. A l’occasion du mouvement du printemps 2009 – une protestation contre les nouvelles procédures d’évaluation des enseignants chercheurs en vue de la modulation des services – on a organisé à l’Ecole des Hautes études des débats hebdomadaires sur les réformes en cours.
A la rentrée universitaire suivante, nous avons lancé un séminaire intitulé « Politiques des sciences », qui avait pour ambition de faire le suivi critique de ces réformes. Ce séminaire existe encore, avec d’autres objectifs, plus larges. Peu à peu a émergé l’idée que nous pourrions faire au sujet des réformes, que nous devrions faire ce que nous savons faire : de la sociologie. Notre intention initiale était de constituer une vaste base de données pour observer les évolutions institutionnelles et les connexions entre les institutions. L’hypothèse était que ces connexions par les acteurs entre lieux de pouvoir permettraient de mieux comprendre ce qui se passe réellement. Ce n’est que progressivement que ce projet a évolué vers un travail sur les carrières des personnels de la réforme.
Joël Laillier : Une réforme, pour marcher, demande l’engagement des personnes qu’il s’agit de réformer : leur mobilisation ou, au moins, leur acceptation du nouveau cours des choses.
Un des troubles qui étaient les nôtres venait de l’observation très concrète, de la participation de collègues au fonctionnement des nouvelles institutions. Et cela à une échelle importante, tant le besoin en personnel des nouvelles agences est considérable : des milliers d’ « experts » pour l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES, créée en 2006). De même, des milliers d’auteurs de projets ont demandé des financements à l’Agence nationale de la recherche (ANR, créée en 2005). Pour faire vivre et administrer ces nouveaux organismes, il fallait recruter un personnel nombreux.
Nous avons voulu comprendre comment se faisait ce recrutement. Et quels étaient les profils, les qualifications recherchées et mobilisées.
Pour chercher à comprendre un système de pouvoir institutionnalisé, il existe plusieurs méthodes, plusieurs approches. On peut le faire à partir des règlements, des lois, des décrets, des statuts. Nous avons préféré partir du fait qu’une institution, surtout une institution qui se veut réformatrice, doit être peuplée et activée par des individus. Autrement dit, nous avons voulu saisir le sens des transformations réformatrices en observant qui sont les individus qui « habitent » les institutions de gouvernement de l’ESR. D’où viennent-ils ? Quelles sont leurs trajectoires professionnelles, leurs lieux de formation et de socialisation ? Avec quelles institutions sont-ils connectés ?
C’est donc à partir de ce maillage individuel des individus dans la réforme, pourrait-on dire, que nous pensions pouvoir comprendre les transformations du pouvoir et des rapports de pouvoir à l’intérieur du champ scientifique.
Vous écrivez : nous sommes passés « d’un monde savant relativement autonome, dans lequel les scientifiques constituent une profession auto-organisée protégée par des institutions et des statuts, à un monde où les pratiques scientifiques sont gouvernées par de nouveaux impératifs politiques et économiques » (p.15). Qu’est-ce qui dans votre enquête, dans ce suivi de multiples trajectoires individuelles et finalement dans cette sociologie des nouveaux dirigeants vient nourrir ce constat ?
Christian Topalov : Les transformations les plus significatives touchent à la fois les institutions et les personnels. Sur les institutions d’abord, le fait majeur est que l’on assiste au remplacement, ou à la marginalisation, d’instances fondées sur l’élection par des agences fondées sur la nomination. Le contraste est immense entre le fonctionnement totalement verticalisé des nouvelles agences (l’ANR et l’AERES-HCERES [1]) et celui des institutions issues des ordonnances de 1945, le Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) et le Conseil national des universités (CNU). Ces deux institutions, créées à la Libération, avaient un but commun : protéger les chercheurs et les enseignants-chercheurs de l’autorité administrative. Le CoNRS devait aussi jouer le rôle d’un « parlement de la science », issu des communautés scientifiques et indépendant du gouvernement.
S’agissant des universités, alors que leurs présidents étaient élus, depuis la loi Savary (1984), par environ 140 personnes, ils le sont désormais par une douzaine de personnes. Des personnes que le président a auparavant cooptées, puisqu’elles ont été élues sur sa liste. Une fois ainsi installé pour huit années (avec un mandat renouvelable de quatre ans), le président, dont les pouvoirs sont accrus tandis que ceux des différents conseils sont réduits, est devenu un véritable « chef d’entreprise » – comme l’avait préconisé l’Académie des sciences en 2004.
Du point de vue de la « démocratique académique », pourrait-on dire, la situation est pire encore dans les universités d’excellence puisqu’elles ont souvent pris le statut d’établissement dérogatoire ou de grand établissement : dans ce système, plus encore lorsque s’adjoint une « fondation de coopération scientifique », on assiste à une complète disparition du contrôle sur la présidence de ce qu’ils appellent les « usagers » – étudiants et personnels.
Cela n’est pas sans effet. Cette concentration des pouvoirs permet, par exemple, que les fonds Idex [2] soient à la main de la présidence sans que les représentants des personnels ou un conseil scientifique aient quoi que ce soit à dire.
Joël Laillier : Si le fonctionnement interne des institutions est considérablement transformé, l’architecture générale, les rapports de pouvoir entre institutions ont aussi changé.
L’ampleur des attributions de l’ANR et de l’AERES-HCERES devait permettre d’obtenir des chercheurs qu’ils fassent la recherche que l’on voulait leur voir faire. Ironiquement, on pourrait dire aussi que ces pouvoirs accrus étaient la condition d’une réforme qui se présente toujours comme soucieuse et garante de l’autonomie et de l’initiative des acteurs – ces deux derniers termes étant célébrés, non sans raison, comme les conditions de l’innovation.
Pour faire fonctionner ces nouvelles institutions de gouvernement de la science, pour assurer ces transformations, il fallait des personnels présentant des qualités compatibles avec les évolutions souhaitées. Notre enquête a permis d’établir que le recrutement de ceux et celles qui ont pris la direction du ministère, des agences, des organismes de recherche et des super-universités ne doit rien au hasard.
Au sein du ministère il y avait jusqu’en 2006, trois directions : la direction générale de l’enseignement supérieur, la direction de la technologie et la direction de la recherche. Recherche et technologie sont fusionnées en 2006. En réalité, c’est la direction de la technologie qui est mise aux commandes de la nouvelle direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI). Alors que la direction de la recherche était essentiellement composée de chercheurs issus de l’état-major du CNRS, la direction de la technologie est principalement composée d’ingénieurs d’Etat. Ils sont souvent engagés dans la « recherche et développement » (R&D) en lien avec les industries stratégiques jadis d’Etat, désormais privatisées.
Ce type de recrutement est donc tout à fait cohérent avec la doctrine de la réforme qui veut que la recherche embraie mieux sur l’innovation technologique et la croissance économique. Cela est aussi très cohérent avec la notion d’ « économie de la connaissance » – mot d’ordre promu de longue date et officialisé en 2000 par le conseil européen de Lisbonne, et qui suppose que la recherche soit prioritairement au service de l’économie.
Précisons que ce genre de personnel – les ingénieurs R&D – n’est pas nouveau dans le paysage de l’ESR. Ce qui est nouveau, en revanche, c’est qu’à la faveur des réformes, ils sont installés au cœur des dispositifs de pouvoir sur la recherche. Car il ne s’agit pas seulement des directions centrales du ministère, mais aussi de la direction des organismes de recherche, y compris le CNRS.
Un exemple nous semble assez significatif. On peut raisonnablement présumer que les dirigeants de l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) ont une conception de la recherche scientifique particulièrement tournée vers des applications industrielles ou commerciales. Or, ces cadres dirigeants sont devenus un vivier de recrutement particulièrement important pour la réforme. En 2019 par exemple, Bernard Larrouturou, un ancien président de l’Inria de 1996 à 2003, était directeur général de la recherche et de l’innovation au ministère, son successeur à la direction de l’Inria de 2003 à 2014, Michel Cosnard, dirigeait le Hcéres, et son propre successeur à la présidence de l’Inria de 2014 à 2018, Antoine Petit, était parachuté à la présidence du CNRS. Trois présidents qui se sont succédé à la tête d’un organisme qui porte une conception de la recherche clairement tournée vers l’entreprise et l’innovation se retrouvent donc, au même moment, à la tête d’institutions cruciales de la recherche en France : le CNRS, l’agence d’évaluation et le ministère. D’autres lieux ont joué un rôle important : la direction du département des sciences du vivant du CEA a fourni successivement deux directeurs de l’ANR (Gilles Bloch en 2005-2006 et Thierry Damerval depuis 2017), deux patrons de la DGRI (Gilles Bloch en 2006-2009, Roger Genet en 2012-2016) ; tous trois passés par plusieurs cabinets ministériels, ils continueront leur carrière par des présidences d’organismes. L’Institut français du Pétrole (IFP), le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) fournit également des dirigeants et des cadres à l’agence de financement de la recherche. Ces organismes particulièrement tournés vers l’industrie s’imposent comme des lieux dans lesquels la réforme recrute son personnel dirigeant.
Au-delà de ces cas, certes tout à fait significatifs, quelles tendances se dessinent plus généralement dans le recrutement des personnels pour les postes de direction de l’ESR ?
Joël Laillier : Globalement, on voit disparaitre certains profils au profit d’autres. Les grands chercheurs qui avaient un fort crédit scientifique et qui, dans une deuxième partie de leur carrière, pouvaient exercer des fonctions plus administratives – nous les appelons les « scientifiques distingués » car ils cumulent des signes de distinctions scientifiques et mondaines – ont eu tendance à disparaître. A l’inverse, ceux que nous nommons les « notables de l’administration de la recherche », qui présentent des pratiques scientifiques relativement faibles et qui se sont engagés précocement dans des fonctions administratives, prennent en charge la politique de la recherche, et plus récemment encore des profils d’ingénieurs qui s’occupe d’innovation, encore plus éloignés de la recherche donc, les remplacent.
Notre enquête, en collectant des informations nombreuses sur les trajectoires professionnelles, permet de mettre en évidence des dispositions à porter certaines visions de la pratique scientifique qui les qualifient pour occuper des postes de direction dans le nouvel ordre de l’ESR. Lorsqu’un individu a consacré l’essentiel de sa carrière à des transferts de technologie, à l’Inserm ou à l’Inria par exemple, sa formation et sa pratique développent certaines façons de concevoir l’activité de recherche. De sorte qu’on peut voir les trajectoires de carrière comme des socialisations qui génèrent certaines dispositions dans l’exercice du pouvoir sur la science.
Les présidents d’université constituent un second corps de réformateurs. On observe une entrée de plus en plus précoce de certains professeurs dans une carrière administrative au sein de leur université. Ceux que nous appelons les « notables de l’administration universitaire » peuplent la direction de la Conférence des présidents d’université (CPU), évidemment, mais se sont aussi retrouvés à la tête de la direction générale de l’enseignement supérieur (DGESIP) et à l’agence de l’évaluation au moment du « big bang » des réformes (2004-2010).
En plus des cadres d’état-major, la réforme a aussi besoin d’une multitude de cadres intermédiaires. L’AERES ou l’ANR ont des besoins de main-d’œuvre colossaux, notamment de milliers d’ « experts », mais aussi d’un personnel interne chargé de piloter ceux-ci. Les neuf « super-universités » ont aussi secrété d’épaisses couches bureaucratiques, que le secret qui entoure généralement leur « gouvernance » rend difficile de connaître. A différents niveaux de responsabilité et de rémunération, en tous cas, les transformations de l’ESR ont aussi offert des opportunités de carrière.
Ces changements dans les profils des états-majors et des cadres intermédiaires du gouvernement de la recherche permettent donc de mieux comprendre le sens général des réformes de l’ESR.
Sur le sens général, justement, un point de votre livre peut étonner. Alors que vous offrez au lecteur une enquête remarquable par sa richesse (une base de données comprenant 15 000 personnes, plus de 500 carrières reconstituées, une centaine de rapports étudiés) et sa rigueur, vous semblez ne pas vouloir vous aventurer vers une lecture trop idéologique de ces transformations.
Plus précisément, alors que ce que vous mettez en évidence pourrait se lire comme la résultante pratique des politiques néolibérales appliquées à l’ESR – d’un néolibéralisme qui trouve et recrute les personnels qui présentent des dispositions qui lui sont nécessaires – vous semblez toutefois refuser l’idée que cette vaste transformation serait l’application concrète d’une idéologie, d’une doctrine.
Joël Laillier : Si on part des individus – comme nous l’avons fait – pour comprendre la réforme, c’est qu’on suppose qu’on est pas gouverné par des idées. Dire cela, ce n’est pas dire que les idées n’ont aucun poids pour comprendre ce que font les individus. Cela ne veut pas dire non plus qu’il n’y a pas de doctrine qui a justifié les objectifs et les moyens de la réforme. Cette doctrine existe, nous l’avons rencontrée [3]. La qualifier de néolibérale est une autre affaire : ce saut vers une interprétation globale ne nous a pas paru nécessaire pour comprendre ce que nous avons observé. Nous pouvons simplement dire que nos résultats ne sont pas incompatibles avec une lecture de la réforme de l’ESR comme une mise en œuvre d’une doctrine néo-libérale, analogue à celle qui frappe l’hôpital, les autres services publics et l’Etat en général.
Mais notre propos est ailleurs, car nous posons que, pour transformer l’ESR, des idées seules n’auraient pas suffi. Pour comprendre la réforme et, plus précisément, pour comprendre comment elle a été mise en œuvre, il ne suffit pas de « dévoiler » une doctrine qui pourrait être considérée comme la cause des réformes. Nous n’avons pas besoin de présumer que les acteurs de la réforme étaient animés d’une « idéologie » ou se sont convertis aux croyances qui ont justifié la réforme. En réalité, des individus, divers dans leur trajectoire professionnelle comme dans leurs convictions, ont effectivement participé à une rupture dans le mode de gouvernement de la science. Connaître leurs raisons d’agir dans leur diversité nécessiterait une toute autre enquête, qui permettrait de décrire au plus fin l’intrication de l’action, des calculs et des croyances, et son évolution au fil du temps. Mais, pour analyser le changement global d’un système de gouvernement – ce qui était notre projet –, cette enquête ne nous a pas paru nécessaire.
Toutefois, les qualités que vous trouvez chez les individus les plus engagés dans la mise en œuvre de la réforme sont précisément les qualités qui sont structurellement appelées à émerger dans les nouvelles institutions.
Joël Laillier : Certes. Mais cela ne doit pas nous empêcher de comprendre que cette réforme ne s’est pas résumée à une opposition simple entre ceux qui étaient convaincus ou convertis et ceux qui étaient critiques. Il y avait aussi, le plus grand nombre sans doute, ceux qui étaient résignés. Et il n’y a aucune raison de présumer que tous les acteurs étaient parfaitement conscients de ce qui était en train de se passer.
Prenons un exemple concret, celui du mouvement Sauvons la recherche de 2004, dont l’histoire reste encore à écrire. Initialement, une des revendications d’une partie des chercheurs mobilisés était la création d’une agence de financement de la recherche par projets. Aujourd’hui, l’agence de financement passe pour typique d’un pilotage néolibéral de la recherche par la mise en concurrence généralisée des chercheurs, la mise en conformité des projets à des objectifs définis politiquement et la création d’une armée de travailleurs précaires. Pour autant, elle était alors une revendication d’une partie des chercheurs eux-mêmes et, si SLR dans son ensemble l’a reprise c’est qu’elle n’était pas du tout perçue de cette façon – puisqu’une autre revendication était l’augmentation des postes statutaires et des financements pérennes. Les promoteurs de la mesure, notamment chez des biologistes à mi-carrière, y voyaient surtout la possibilité d’obtenir un accès direct aux financements qui les rendrait plus indépendants des mandarins de leur labo – sans parler de la disposition de petites mains pour faire leurs manips. Les réformateurs et le gouvernement ont alors eu l’intelligence politique de s’engouffrer dans la brèche : ils ont créé l’ANR dès le début de l’année suivante.
Christian Topalov : Le cas de SLR est très intéressant, car il montre bien que les différents acteurs peuvent donner un sens différent aux mêmes mesures, la signification finale n’apparaissant que par la suite.
On peut prendre un autre exemple, celui de la Conférence des présidents d’université. La CPU a été aux avant-postes pour la revendication de l’autonomie des universités (c’était le titre de leur conférence annuelle en 2001). Pour cet acteur collectif, l’autonomie revendiquée signifiait plus de pouvoir pour les présidences, moins de tutelle administrative, moins de limitations et contrôles en interne. Mais, lorsqu’on commença à parler de sélection d’un petit nombre d’universités de rang mondial pour des financements exceptionnels, la CPU a protesté avec véhémence : rien ne serait plus funeste pour l’université française. Elle appuyait donc un aspect de la réforme et pas l’autre. Ce qui n’a pas empêché la plupart de ses dirigeants de se précipiter lorsque le concours des idex a été ouvert en 2010 : « il faut s’adapter ».
Il en a été ainsi tout au long du processus de réforme. Les gouvernants ont toujours procédé par petits pas, sans annoncer ce qui viendrait ensuite – c’est la « réforme incrémentale » préconisée par le rapport Aghion-Cohen de 2004. Ceux qui réclamaient « l’autonomie » des universités imaginaient que la tutelle du ministère serait levée (ils ont déchanté depuis), mais ils n’imaginaient pas tous qu’elle aurait pour conséquence une mise en concurrence généralisée des établissements, ceux qui demandaient une ANR ne savaient pas que la croissance du financement par projet s’accompagnerait d’une forte réduction des postes et des crédits récurrents, ceux qui participèrent aux premières campagnes d’évaluation de l’AERES ne pouvaient pas savoir que la note attribuée aux laboratoires déterminerait leur inclusion ou exclusion des « périmètres d’excellence », condition d’accès aux fonds du « grand emprunt ». Incertitude sur les conséquences des mesures prises aujourd’hui, ignorance de celles qui seraient prises demain.
Joël Laillier : C’est bien pourquoi nous pensons que la doctrine s’est construite à mesure de son effectivité. En travaillant sur les multiples rapports qui ont accompagné les réformes, nous avons observé que les mots (« autonomie », « excellence ») ont changé de sens au fur et à mesure que la réforme s’imposait. Il y a eu une phase cruciale d’élaboration des principes généraux et de la stratégie de la réforme (2004-2010). A ce moment, contrairement à ce que nous avons pu observer sous le gouvernement Jospin qui avait précédé, on peut dire qu’une doctrine d’ensemble était disponible : « économie de la connaissance », autonomie, gouvernance, évaluation, différenciation. Sous Hollande, la référence à ces principes s’estompe : il faut surtout empêcher de « revenir en arrière », d’où la consolidation de toutes les mesures précédentes, surveillée par des rapports d’inspection et accompagnée d’une insistance nouvelle sur des objectifs « progressistes » (démocratisation du recrutement, réussite étudiante). Cet effacement relatif de l’affirmation de la doctrine est précisément le signe de la victoire des réformateurs : une doctrine en actes n’a pas besoin de proclamations. Avec Macron, c’est une nouvelle phase : on assiste à une mise en œuvre des préconisations réformatrices les plus radicales (sélection à l’entrée de l’université, université payante pour les étrangers, statuts quasiment libres pour les « établisssements expérimentaux », déni du rôle du CNU, priorité encore plus massive à la recherche sur projet). Et ce n’est pas fini : le discours du candidat Macron devant la CPU en 2022 reprend tous les traits déjà acquis de la doctrine tout en introduisant de nouveaux (université payante, notamment).
Ainsi, parmi les diverses revendications, parmi les diverses propositions de réforme s’opère une sélection qui va, finalement, fermer la question de la réforme de l’ESR : la mise en forme du problème est stabilisée, les solutions aussi. Ce n’est qu’à ce moment-là, ex post, par conséquent, qu’une cohérence apparaît.
[1] L’AERES devient Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) en 2013. C’est la seule réforme significative que l’agence a connu lors de l’alternance Hollande.
[2] Les « initiatives d’excellence » (Idex) sont des regroupements d’universités et d’établissements qui ont reçu ce label au terme d’un concours lancé en 2010 et supposément arbitré par un « jury international ». En conséquence, et à la condition d’adopter une « gouvernance resserrée », ils bénéficient de financements considérables issus du « grand emprunt » lancé lors de la présidence Sarkozy.
[3] Si l’on cherche une doctrine, on peut s’attarder sur trois rapports tout à fait significatifs : le rapport Aghion-Cohen de 2004, qui impose le thème de l’économie de la connaissance et la jonction nécessaire entre éducation et croissance, le rapport Goulard de 2007 qui définit les grands traits de la LRU et enfin le rapport Aghion de 2010 pour Pécresse qui définit les politiques d’excellence, i.e.{} la création de super-universités dites de rang mondial.
