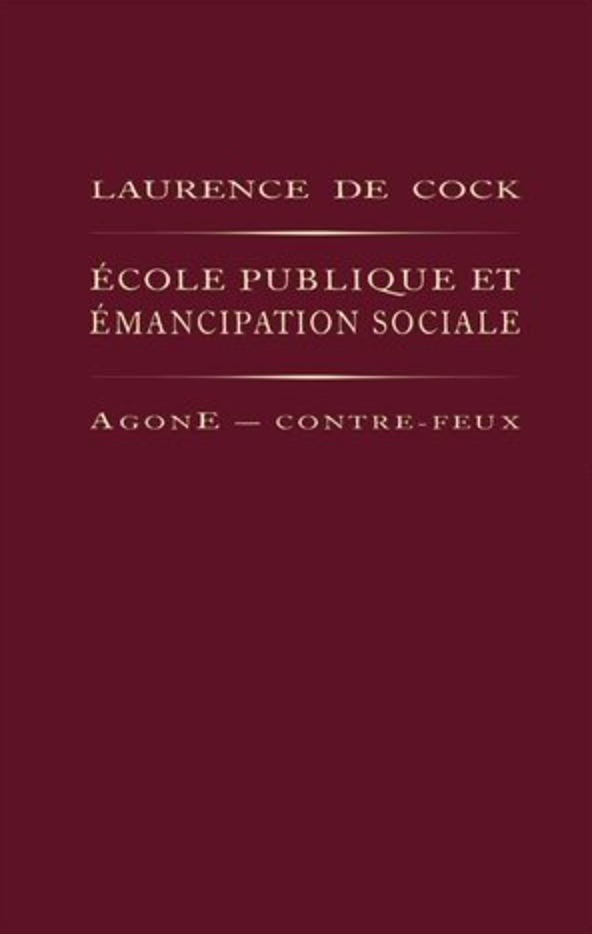
Laurence De Cock livre un bilan des réformes éducatives récentes et de leurs conséquences désastreuses. Mais au-delà, elle s’appuie sur les volontés historiques d’une école égalitaire pour questionner les conditions qui permettraient à l’école publique de jouer son rôle d’émancipation sociale. Un appel à se « mettre sérieusement au travail » pour qu’une autre école publique, au service de l’émancipation des enfants des classes populaires devienne possible.
Laurence DE COCK
École publique et émancipation sociale
Agone, 2021, 216 pages, 16€
Trois questions à Laurence De Cock
Propos recueillis par Paul Devin
Votre livre s’ouvre sur un bilan sévère de la politique scolaire actuelle, tout particulièrement en ce qui concerne les enfants des classes populaires. Quels sont les signes les plus clairs de la volonté de cette politique d’avoir «mis fin à l’objectif de démocratisation scolaire»?
Partons d’une définition minimale de la démocratisation scolaire qui serait la garantie offerte à tous les enfants du pays d’effectuer la trajectoire scolaire de leur choix. C’est une définition qui ne repose pas sur une norme socialement construite de « réussite » scolaire et qui insiste sur le point essentiel de l’orientation non subie. Il est clair que tous les ministres commencent leur mandat en déclarant la main sur le cœur qu’ils lutteront sans merci contre les inégalités scolaires et que c’est leur priorité. Toutefois, la plupart ont préféré affiner les modalités de tri plutôt que le supprimer. Dit autrement, on a aujourd’hui des politiques éducatives qui prétendent privilégier l’individualisation des parcours pour coller au plus près des profils des enfants et qui justifient cela en disant que cela permet d’aider les élèves les plus en difficulté. En réalité, même si personne ne peut évidemment s’opposer aux accompagnements individualisés, cela comporte le risque de capituler à la fois sur la dimension collective de la classe, mais surtout d’institutionnaliser une pédagogie du profilage d’élève que l’on va désigner comme « plus manuel », « scientifique », « littéraire », souvent en projetant sur l’élève nos propres représentations. De la sorte, l’institution, même à son corps défendant, assigne aux élèves une place sociale dans laquelle il est censé se sentir le mieux car on lui aura fait croire qu’elle a été choisie. C’est un phénomène très largement décrit par la sociologie de l’éducation. Dans cette logique, l’élève qui quitte sa place est un « miraculé », il a déjoué le sort, et on le félicite pour avoir court-circuité les règles du jeu, c’est son « mérite ». Le ministère Blanquer a donné un coup d’accélérateur à cela par son culte béat des sciences cognitives, notamment des neurosciences qu’il instrumentalise pour fournir une caution scientifique à ces dispositifs individuels. Or on sait bien que le critère déterminant des difficultés de certains élèves est social, et qu’une véritable politique de démocratisation scolaire passe par une redistribution des richesses et une réflexion de fond sur la culture scolaire beaucoup trop profilée encore par la culture bourgeoise. Par ailleurs, scientifiser les difficultés d’apprentissage et se contenter de cela, permet de faire l’économie (dans tous les sens du terme) d’en finir avec les privilèges de la bourgeoisie en matière d’éducation. Blanquer assume tout cela sans faux semblant, on le voit dans ses cadeaux au privé, dans la création des écoles internationales dont on sait bien qui elles ciblent, dans la réforme du lycée et du Bac qui intensifie les différences entre établissements ou encore dans Parcoursup qui est un système de tri reposant en priorité sur la valorisation du capital culturel des lycéennes et lycéens. Je parle donc de « contre-démocratisation scolaire » car il me semble que nous avons vécu ces quatre dernières années un frein sans précédent et que tout cela opère avec un consentement de la société assez inquiétant.
Les pédagogies nouvelles, tout au moins celles qui se fondent sur une perspective d’émancipation, seraient-elles capables de permettre à l’école publique de dépasser les limites de son modèle méritocratique pour permettre une véritable démocratisation ?
Dans ce livre je reviens longuement sur cette galaxie des pédagogies dites « nouvelles » (qui ne le sont plus vraiment). Il me semblait important de rappeler que cette mouvance appelée « éducation nouvelle » est en réalité très divisée, notamment politiquement. Pour le dire rapidement, elle est traversée par un clivage majeur sur ses finalités que l’on peut résumer de la manière suivante : la pédagogie doit-elle servir la transformation sociale ou se contenter de « faire réussir » les élèves en difficulté ? Ces divisions ont généré des tensions très fortes au sein même de la Ligue Internationale d’éducation nouvelle créée en 1921. Elles sont par exemple à l’origine des colères de Célestin Freinet contre la ligue qu’il trouvait beaucoup trop timorée face à la montée des régimes fascistes et qui considérait que la mission de la pédagogie était d’abord et avant tout de défendre le caractère public de l’école et de focaliser ses efforts sur les enfants les plus pauvres. Cette finalité de justice sociale est mise en avant par de nombreux autres pédagogues un peu « patrimonialisés » comme Francisco Ferrer, Paul Robin, Louise Michel et plus récemment Paulo Freire, mais aussi et surtout par d’autres acteurs et actrices plus méconnus mais impliqués dans des organisations pédagogiques (ICEM, GFEN) ou syndicales qui sont les héritières de ces visions de la pédagogie. On pourrait les définir de la manière suivante : des pédagogies qui accordent une place importantes aux connaissances rationnelles et au rôle de l’école comme espace de construction et transmission de savoirs ; qui souhaitent également une éducation dite « intégrale » c’est-à-dire sans hiérarchie entre disciplines, notamment celles dites manuelles et intellectuelles ; des pédagogies qui réfléchissent également à des dispositifs d’expériences démocratiques et sociales à l’intérieur des classes et forment les enfants aux idéaux de justice sociale à travers une sensibilisation aux dominations et à leur nécessaire critique. Ces pédagogies, grossièrement définies ci-dessus, souffrent de plusieurs caricatures. D’un côté on les assimile à du « pédagogisme » et les accuse de concurrencer les savoirs et d’être à l’origine de la perte d’exigence intellectuelle ; d’un autre côté, on dénonce leur caractère trop politique et militant qui n’aurait pas sa place dans l’école, sanctuaire de la neutralité. Les deux accusations sont illégitimes et témoignent d’une méconnaissance importante en France de l’histoire de la pédagogie et de la difficulté de se départir de réflexes élitistes entretenus par une profession enseignante (surtout dans le secondaire) qui s’arcboutent sur la dimension savante de leur métier, y compris pour sauver au moins cela de la disqualification sociale qu’ils subissent, ce que l’on peut comprendre.
Ces pédagogues ont pourtant produit des écrits très nombreux dans lesquels ils déminent toutes ces critiques, et on y trouve un vrai potentiel de réforme de l’école publique, mais cela suppose une refonte entière de la formation des enseignants et la réhabilitation des pédagogies d’émancipation sociale que l’on ne peut pas attendre d’un gouvernement libéral lequel vise au contraire à un utilitarisme immédiat de la pédagogie et privilégie les aspects techniques des pédagogies dites « alternatives ». D’où les succès d’expérimentations autour des pédagogies Montessori ou d’autres pédagogies présentées comme « explicites » et vantées comme scientifiquement efficaces alors que la pédagogie Freinet par exemple est de plus en plus criminalisée.
Pour répondre à votre question, on ne peut pas présager de l’effet magique des pédagogies d’émancipation sociale mais il y aurait un vrai intérêt à les travailler collectivement et à leur donner droit de cité dans les classes, surtout en ces temps de démantèlement de l’école publique et du risque que disparaissent avec elle l’idéal de justice sociale qu’elle porte.
Résister, contre-attaquer, riposter : sur quelles urgences, sur quelles priorités, les enseignantes et les enseignants et plus généralement les personnels de l’Education nationale devraient-ils engager cette riposte ?
Je ne vois pour le moment qu’un seul aspect positif dans la période de campagne présidentielle qui s’ouvre : l’opportunité de prendre la parole et la possibilité d’être un peu plus entendus que d’habitude. C’est donc le moment de faire connaître les effets délétères de ces quatre dernières années et redonner ses titres de noblesse à l’expertise de terrain. Pour cela, il faut encourager les collectifs syndicaux ou non et multiplier les rapports de force. L’école « publique » (et j’insiste sur l’adjectif) doit être au cœur de la campagne des gauches en lice qui doit réaffirmer ses principes fondateurs : la gratuité, la laïcité, l’émancipation sociale. Il faut également engager un bras de fer urgent contre la langue néolibérale qui pollue notre métier : l’ « agilité », le « pilotage », la « gouvernance », cette langue des mots creux qui nous vampirise et réduit l’éducation à un simple projet entrepreneurial. C’est là l’un des pires dangers car le néolibéralisme est hélas aussi désirable pour certains enseignants qui se laissent prendre à l’appât de la reconnaissance et de la récompense au mérite. En ces temps de relégation sociale du métier, on voit bien que la mission de service public a tendance à être ringardisée alors qu’elle est résolument moderne au contraire. L’efficacité de ce néolibéralisme désirable se voit aussi à travers le nombre grandissant de familles de gauche, parfois radicale, qui délaissent l’école publique pour des expérimentations privées présentées comme l’avant-garde du monde de demain alors qu’elles sont inaccessibles aux enfants les plus pauvres et qu’elles fonctionnent davantage comme des zones de confort que comme des écoles. Déserter l’école publique et lui préférer des écoles alternatives, c’est mettre un jeton dans le démantèlement du service public d’éducation et laisser des milliers d’enfants sur le carreau. C’est une responsabilité collective lourde qui doit être rappelée. Enfin, je consacre dans mon livre tout un chapitre à quelques pistes pour la refondation d’un contrat entre l’école publique et la société. Il en va des droits de l’enfant et de l’idéal de redistribution de richesses ; je ne vois pas bien en quoi ces principes seraient dépassés.
