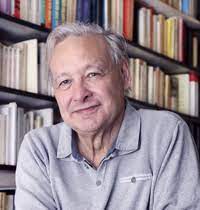
Colloque 2 et 3 juin 21 : le syndicalisme au défi du XXIème siècle
Intervention de Jean-Marie Pernot, chercheur IRES
Il faudra un recul de quelques années pour apprécier véritablement dans quel contexte nous nous trouvions en ce printemps 2021. La seule chose à peu près connue aujourd’hui est que nous déboucherons une fois la pandémie maitrisée sur une crise sociale de très grande ampleur avec ses effets sur l’emploi, sur les inégalités, la situation de nombreux jeunes et, probablement, des effets importants sur le travail.
Pour autant d’autres tendances doivent être prises en compte qui ne sont pas toutes, liées à la pandémie. Peut-être celle-ci a-t-elle accru la perception de certaines évolutions mais il existe d’autres mouvements de fond dans la société qui sont antérieures à la crise sanitaire. J’en évoquerai trois sans m’y attarder puisque, ce n’est pas un hasard, elles font l’objet de débats particuliers dans ce colloque : la montée des questions écologiques, l’exigence féministe et enfin, les questions qui entourent l’activité de travail. Mais je m’arrêterai surtout, parce que c’est là qu’on m’attend, sur la situation du syndicalisme « réellement existant » par opposition au syndicalisme souhaitable qui m’en paraît hélas assez éloigné.
Le syndicalisme n’est pas interpellé de la même manière dans les trois domaines que je viens d’évoquer : le travail est en principe son « fonds de commerce », j’en dirai un mot ; il est lui-même travaillé par la question féministe en raison de ses traditions et de ses coutumes fortement marquées par l’héritage masculin industriel ; enfin sur la question de l’écologie, tout reste à faire, ou presque. Si avec d’autres mots, la CFDT en avait fait un terrain de lutte dans les années 1970 (sous la forme de la lutte contre « les dégâts du progrès »), elle l’avait largement abandonné si ce n’est dans les textes, au moins dans la pratique, depuis son recentrage sur l’entreprise. Elle a renoué avec ce thème récemment en s’associant à la fondation Nicolas Hulot et quelques autres, mais sans en faire un terrain de lutte puisque la notion même de terrain de lutte n’a pas encore fait son retour dans les représentations confédérales.
Cette initiative et le regroupement « Plus jamais ça », apparu récemment marquent en quelque sorte l’entrée du syndicalisme « en écologie » sans masquer que cette initiative est loin de faire l’unanimité dans les rangs syndicaux, ce qui est bien normal pour un syndicalisme très marqué par l’héritage industriel.
Ces trois terrains n’épuisent pas le cahier revendicatif, bien sûr, car emploi, pouvoir d’achat et conditions de travail ne sont pas près de céder la place dans l’action syndicale quotidienne. Mais on peut émette l’hypothèse que ces trois thèmes peuvent cadrer un certain nombre d’enjeux décisifs pour le mouvement syndical.
Je n’en dirai pas plus sur les thèmes qui vont faire l’objet de débats spécifiques dans ce colloque, si ce n’est sur le travail, après quoi j’en viendrai à quelques considérations sur les capacités du syndicalisme à surmonter ces défis.
Le travail, un sujet protéiforme
Depuis la fin des années 70, le syndicalisme s’est davantage préoccupé, le constat est banal, des questions d’emploi que du travail à proprement parlé. Chômage de masse oblige ! La question n’a pas disparu : la poursuite de la casse industrielle et l’externalisation massive génèrent un grand nombre de conflits autour de l’emploi. Il ne s’agit pas de prétendre donc que les questions d’emploi ont cédé la place à d’autres préoccupations mais les questions du travail se sont incontestablement enrichies d’autres dimensions dont il sera sans doute question cet après-midi.
Je pense en particulier aux questionnements liés au rapport au travail qui, bien avant la pandémie et l’extension du télétravail, montraient une mise en cause pas encore très explicite mais assez présente du rapport de subordination.
Il y a bien sûr tout le pan des évolutions technologiques, l’expansion du numérique et de l’intelligence artificielle qui, d’une manière ou d’une autre, va soit remplacer du travail humain soit modifier profondément l’exercice de celui-ci. Il y a un conflit potentiel autour de l’appropriation du temps gagné grâce aux techniques nouvelles, mais au-delà de ça, il y a une remise en cause sourde du rapport de subordination qui sous-tend le rapport salarial et tout l’édifice juridique du droit du travail.
L’échange implicite entre acceptation de la subordination versus extension des droits sociaux propre à la période fordiste est caduc depuis que le néolibéralisme a entrepris la défaisance des services publics mais aussi la précarisation de la relation d’emploi, l’intensification du travail et un contrôle accru dans l’exercice de l’activité. L’emprise du capital sur le travail s’est accentuée depuis des décennies : la dictature de « la gouvernance par les nombres », la pression permanente des indicateurs, les méthodes managériales du type Lean management et ou le New public management dans le secteur public sont omniprésentes ; le pilotage par les algorithmes propres au travail de plateforme est amené à s’étendre bien au-delà, mais ce qui est important, c’est de voir que cet extraction du travailleur de ses œuvres fait l’objet de contestations croissantes, la gouvernance par les nombres connait une assez forte délégitimation parmi les salariés.
Avoir son mot à dire, intervenir sur le contenu du travail, dénoncer l’absurdité des indicateurs ou la politique du chiffre, légitimer le regard critique sur les missions pour les agents publics, remettre en cause les productions ou les services non éthiques, c’est mettre un coin dans la société de surveillance qui commence dans l’hétéronomie du travail.
La CFDT et la CGT ne sont pas restées extérieures à ces tendances ; la CFDT avait piloté il y a quelques années un questionnaire-sondage auprès des salariés sur leur rapport au travail dont les résultats étaient intéressants, il est dommage que ça n’est débouché sur aucune initiative concrète. Et la CGT a initié en son sein pendant dix ans un chantier « Travail et émancipation » qui combinait action et réflexion de manière prometteuse avant qu’il ne soit interrompu fin 2019 pour des raisons encore non élucidées.
Il y a bien sûr aujourd’hui des enjeux de plus court terme avec l’extension du télétravail, qui pourrait connaître un tournant opportuniste après l’épisode de la pandémie. Nombre d’entreprises ont déjà rendu des m2 de bureaux et prévoient de remplacer le présentiel classique par des journées alternantes sur place : la notion de collectif de travail risque de connaître des bouleversements importants sans parler des communautés d’action collectives passablement étirées dans l’espace. Des actions ont vu le jour comme la télégrève organisée à distance chez IBM en avril dernier mais ce type de mobilisation risque de rester exceptionnel, celle-ci a concerné une petite centaine de personnes, tous cadres et assez pointus dans le maniement de l’outil informatique.
Je ne dirai rien des enjeux féministes et écologistes qui seront traités dans la suite de ce colloque pour en venir à une question qui est de savoir si le syndicalisme réellement existant aujourd’hui est apte à les prendre à bras le corps et s’il est capable et à quelles conditions de reconstituer autour de ces questions une véritable puissance d’agir dans son champ de responsabilité.
J’ajouterai une dernière hypothèse sur ce contexte dont j’admets volontiers le caractère spéculatif. C’est l’hypothèse d’une crise de l’utopie néolibérale. Il est frappant de voir comment en peu de temps, les principes cardinaux d’organisation économique du néolibéralisme ont pris l’eau avec cette crise. Mais la taxation des plus riches, celle des entreprises multinationales, le dogme de la dette publique, tous ces poncifs assenés depuis l’entrée dans le « consensus de Washington il y a 30 ans, tout cela semble aujourd’hui sur la table. Alors certes, ça vient surtout des Etats-Unis et non pas de l’Union européenne encore engoncée dans les préceptes de l’ordolibéralisme ; et il ne s’agit pas non plus d’attendre patiemment la réforme du capitalisme par lui-même mais ça ouvre un champ de possibles nouveau qui doit faire partie des données de la période qui vient. A moins que je ne succombe moi-même à un travers que je reproche souvent à d’autres et qui est de hisser sa propre impatience à la hauteur d’un argument théorique…
Un contexte syndical préoccupant
Danielle Tartakowsky a utilement rappelé la combativité maintenue dans de larges fractions de la population enrichie même par de nouvelles catégories entrées dans la lutte au cours des années récentes comme les GJ bien sûr. Il faut rappeler en effet qu’il y a de nombreuses luttes en cours et même des luttes victorieuses comme celle des femmes de chambre de l’IBIS Batignolles qui ont fait reculer Accor, une des plus grandes entreprises multinationales françaises, ce qui n’est pas rien.
Ces luttes montrent en effet un potentiel qui peut constituer un terreau fertile pour la reconstitution d’un syndicalisme combattif et ouvert capable d’embrasser la totalité du champ social et des enjeux que nous avons évoqués.
Mais le problème est là : pour être davantage qu’une collection de luttes, c’est-à-dire pour passer d’une série discrète de conflits à la constitution d’un rapport de force sur l’ensemble du champ social, il faut pouvoir construire des processus cumulatifs qui emmagasinent de la puissance.
On oppose parfois y compris dans notre littérature sociologique, le syndicalisme de mouvement social et syndicalisme institutionnel, mais c’est la combinaison des deux qui crée de la puissance : il ne suffit pas d’enchaîner des mouvements sociaux, nous le savons assez depuis plus de 20 ans pour consolider des rapports de force.
Mais le lieu où peut le mieux s’emmagasiner cette puissance, c’est bien sûr dans la constitution d’un syndicalisme fort, fort en adhérents, en implantations, en capacité de rayonnement là où il n’est pas, bref, ce que fut et que n’est plus le syndicalisme français.
L’actualité récente nous fournit un état des lieux du syndicalisme tel que reflété par les résultats aux élections de représentativité du secteur privé. La publication de ces résultats n’a pas vraiment fait évènement, il faudra des analyses plus complètes qui viendront en leur temps.
En deux mots, qu’y apprend-on ?
L’hégémonie passée de la CGT s’estompe, le terme est faible, mais aucune hégémonie alternative ne prend sa place ; la CFDT progresse peu en pourcentage et perd d’ailleurs 39 000 électeurs par rapport au tour précédent alors que le collège électoral comptait 870 000 inscrits supplémentaires. Elle n’est première que du recul assez spectaculaire de la CGT sur les dix dernières années après avoir perdu 53 000 suffrages entre 2013 et 2017, elle en perd à nouveau plus de 150 000 entre 2017 et 2021. FO perd aussi des suffrages mais la stabilité l’emporte comme pour la CFTC et pour Solidaires. Seuls progressent la CFE-CGC et l’Unsa dans un océan d’abstention.
Le collège électoral est de 14 M d’inscrits et la participation a reculé de 4,5 points. Mais il y a, en 2020, un peu plus de 19,6 millions de salariés en France selon l’Insee. Si on rapporte le nombre de votants à l’ensemble, c’est-à-dire à ce qui constituait jadis le collège électoral des élections prud’homales, on arrive à 25 %, c’est-à-dire le taux de participation de la dernière élection prud’homale de 2002 qui avait valu l’abandon de ce scrutin au motif d’un manque de représentativité.
Cette désaffection était déjà perceptible dans les enquêtes d’opinion : la déclaration de confiance dans les syndicats a reculé brusquement depuis 2012 et quelques frémissements depuis lors n’ont pas enrayé cette chute qui plaçait, en 2012, la confiance dans les syndicats à la hauteur de celle à l’égard des banques et de l’Eglise catholique !
Certes il faut prendre tout cela avec précaution, ces chiffres ne délivrent pas la vérité de la représentation, on ne peut s’empêcher toutefois d’être inquiet surtout que d’autres signaux apparaissent dans le même temps : les cortèges de tête dans les manifestations, les attaques et insultes à l’égard des militants ne peuvent pas être mis au seul débit de cette intrusion nouvelle – et inquiétante au demeurant – de l’extrême droite dans les manifestations syndicales.
Le syndicalisme n’inspire plus le respect qui va naturellement aux puissants. Les difficultés d’exercice de la grève et de la grève pénalisante pour l’économie sont évidemment le signe le plus tangible de ce manque de puissance, ce qu’on appelle dans la recherche comparative la « puissance structurelle » du syndicalisme.
Mais il y en a d’autres signes de perte de substance. Parmi ces autres, il y a la faible, très faible implantation syndicale dans le secteur privé et surtout un grand écart entre la sociologie du syndicalisme et la dynamique du salariat. Tout cela est documenté, je n’y insiste pas et je n’apprends rien à personne.
Mais pour l’instant, il faut bien constater que les grandes centrales syndicales, pour conscientes qu’elles soient de cette situation n’ont pas fait grand-chose pour y remédier : à l’évidence, les incantations à la syndicalisation, les campagnes publicitaires pour leur sigle n’évoquent rien qui stimule le geste de la syndicalisation. Celui-ci est conçu comme une démarche individuelle à encourager y compris par les moyens du marketing. Le problème est que ça ne marche pas parce que le besoin de syndicalisation n’est pas spontané, il ne découle pas simplement d’une conscience d’être exploité ou dominé et ce n’est pas non plus une stricte démarche individuelle ; c’est aussi et peut-être d’abord un fait collectif. Les grands moments de syndicalisation (1936, 1945) sont des moments politiques au sens le plus général du terme mais où la forme « syndicat » apparaissait à une échelle de masse comme un acteur déterminant de la production de la société.
Cette perception fait sérieusement défaut aujourd’hui dans une grande partie de ce qu’il faut bien appeler des déserts syndicaux. Il y a toujours des lieux que le syndicalisme ne touche pas mais ils sont devenus si nombreux et si cruciaux aujourd’hui que cela nuit à la crédibilité du syndicalisme même là où il a conservé des forces. Je cite volontiers cette formule empruntée à un discours d’ouverture d’un congrès de la CGT prononcé par Bernard Thibault, en 2006, qui disait que « pour être fort chez soi, il faut être fort partout ». Il y a aujourd’hui tellement d’endroits où le syndicalisme est faible ou absent qu’il a du mal à être puissant même là où il semble avoir conservé des forces.
Par exemple, le syndicalisme cheminot a montré une certaine force en 2019, contre l’abandon du statut pour le recrutement des jeunes entrants.
Ce conflit avait un contenu fort de référence aux missions de service public. Pourtant il a peu rayonné, peu sur l’ensemble de la filière rail, les transports publics urbains en général et pas du tout dans la sous-traitance de la SNCF qui n’est pas rien.
Il n’a pas eu l’effet d’entraînement de 1995. En 1995, la grève des cheminots exerçait un effet sur la totalité du champ social, en 2019, c’était une grève d’entreprise.
Depuis quelques années, un débat semble avoir surgi pour savoir si le syndicalisme était mortel ou éternel. Ce n’est pas un débat intéressant parce qu’on ne sait pas de quel syndicalisme on parle. Là où le syndicat d’entreprise fait son travail routinier d’animation du CSE et de la négociation annuelle obligatoire, il est utile à ceux qui en bénéficient, c’est-à-dire ceux dont le statut de travail est celui de CDI de l’entreprise. Il peut également être utile à l’employeur qui saura en faire un usage éclairé dans sa gestion managériale : cette forme syndicale-là survivra quoi qu’il advienne autour de lui. Mais un syndicalisme acteur du changement social, capable d’embrasser la totalité du champ salarial, de peser sur les politiques publiques et de poser une empreinte sur le devenir de la société, celui-là est déjà dans la difficulté, pour rester dans la litote.
Comment sortir de cette spirale ? La difficulté n’est pas qu’en France, nous l’avons montré dans un ouvrage collectif de chercheurs européens paru en 2018 à l’Institut syndical européen.
Danielle Tartakowsky a exposé quelques effets de cette décomposition/recomposition qui est à la fois celle du syndicalisme en tant que forme sociale travaillée par les transformations du monde du travail mais qui affecte en propre chacune de ses composantes.
Il me semble et ce sera mon dernier point, qu’au-delà des terrains revendicatifs que j’ai évoqués et dont nous parlerons au cours de ces deux jours, deux dimensions se détachent, importantes parmi d’autres pour un processus de recomposition d’une puissance d’agir syndical. Je crains malheureusement de devoir répéter un peu des choses que j’ai déjà dites et écrites, moi et d’autres, mais je me permets d’insister parce qu’elles sont aujourd’hui un peu délaissées par les acteurs. La question des structures syndicales et celle de l’unité ou de la division syndicale.
L’inadaptation structurelle
L’organisation interne des confédérations, ce qu’on appela à une époque les partitions internes du salariat sur lesquelles reposent les centrales syndicales sont un héritage de la longue durée, qui viennent à la fois du syndicalisme de métier transformé en syndicalisme d’industrie au début du XX° siècle qui s’est consolidé encore autour des professions dans l’après-guerre avec l’installation des conventions collectives ; les confédérations tiraient de leur côté une légitimité par leur influence sur la mise en place de l’État social, comme Danielle l’a rappelé. Elles ont perdu un peu de contenu, cela, tout le monde le constate mais on parle peu de la crise tout aussi importante qui affecte la représentation professionnelle. Les fédérations qui constituent, à la CGT notamment mais aussi à FO, les pièces maitresses de l’organisation interne ne sont aujourd’hui adaptées ni aux interrelations économiques effectives ni aux objectifs de solidarité entre les travailleurs qui sont au fondement du syndicalisme confédéré.
Le capitalisme se recompose en permanence et il serait utile d’en tenir compte : certaines branches gardent du sens mais qui ne suffit pas à construire une communauté agissante. L’importance de la sous-traitance et de l’externalisation, la part prise dans les collectifs de travail par les prestataires, les intérimaires et autres formes de délégation de la gestion du personnel obligent, devrait obliger, à repenser les modes d’organisations : la plupart de conflits récents sont des conflits de la sous-traitance ou la mettent en jeu : les hôtels déjà cités, les fonderies dans l’automobile, dans l’aéronautique, on peut ajouter à l’infini car plus de 80 % des entreprise sont dans une relation de sous-traitance, comme sous-traitant ou donneur d’ordre, ou les deux, même la fonction publique : 160 milliards d’€ sont dépensés chaque année par l’État dans l’externalisation de la prise en charge de ses missions. Et ce n’est pas fini, je signale au passage que la loi sécurité qui a fait beaucoup parler sur l’article 24 comprend également des dispositions qui permettent de confier une part croissante des missions de sécurité à des sociétés privées.
Les communautés d’action collective doivent être reconstituées dans ce sens c’est-à-dire franchir les frontières des sacro saintes « professions » sur lesquelles restent assis les modes de représentation internes aux organisations, tout simplement parce que, dans la plupart des cas, sous-traitants et donneurs d’ordre relèvent de professions ou de conventions collectives différentes ce qui rend en grande partie caduques les frontières internes sur lesquelles se sont construites les organisations. Il ne s’agit pas de supprimer la dimension professionnelle, bien sûr, mais de la priver de son rôle séparateur dans l’appréhension de la communauté d’action collective.
Certaines centrales syndicales ont des structures plus ou moins souples, elles réorganisent un peu leurs champs fédéraux tout en conservant le modèle référentiel de la fédération professionnelle La CGT se distingue un peu car depuis 30 ans et plus, la plupart des fédérations figent totalement les évolutions si ce n’est à la marge. Heureusement, quelques structures locales n’ont pas attendu le changement d’en haut et ont commencé à mettre en place des communautés multi ou interprofessionnelles d’organisation de travailleurs et travailleuses dispersés dans les petites entreprises du lieu. J’en devine dans cette salle virtuelle qui se réjouissent de voir revenir le One Big Union des Wobbbies américains du début du XX° siècle mais le fait est là : aujourd’hui le mode d’organisation apte à créer une véritable solidarité et des communautés d’action collective doit être interprofessionnel, sinon toujours, du moins dans une grande partie du monde du travail.
Le débat à la CGT porte beaucoup sur les grandes orientations idéologiques et on n’y est pas avare de surenchères sur la classe et la lutte des classes. Mais lorsqu’il s’agit de prendre des mesures pratiques pour instituer la classe, c’est-à-dire mettre en mouvement le large spectre de travailleurs et de travailleuses qui potentiellement la constituent, on constate beaucoup moins de volontarisme.
La question des modes d’organisation est souvent caricaturée comme un débat d’intendance mais ce n’est pas ça du tout. La manière de découper l’espace social pour saisir les groupes sociaux dont on souhaite construire une représentation, est une question déterminante de la capacité effective du syndicalisme à représenter les travailleur.se.s. Par ailleurs si l’on considère toujours la pertinence d’une réflexion en termes de classes et de lutte des classes, il n’est pas possible de se dispenser d’une réflexion sur ce qui institue la classe : est-ce l’addition de groupes professionnels sur le papier ou est-ce la dynamique de constitution d’une conscience collective à travers des pratiques de luttes partagées et de solidarité ? Pour cela, il faut s’organiser pour que cela soit possible ! C’est donc bien une question politique par excellence.
L’impossible esprit unitaire
Le deuxième point que je voulais soulever est celui de la division syndicale. On sait, Danielle l’a rappelé, qu’elle est ancienne, elle naît dès l’après première guerre mondiale. La naissance d’un syndicalisme chrétien avec la petite CFTC en 1919 puis la création de la CGTU en 1922 installent une double partition au sein du mouvement syndical : un axe confessionnel entre CGT et CFTC ; le second est un axe stratégique, réformiste versus révolutionnaire avec la coupure CGT/CGTU.
En 1945, la naissance de la CGC introduit un nouvel axe, catégoriel celui-là mais incomplet puisque les autres centrales organiseront elles-aussi les personnels d’encadrement. Depuis 1947 et le big bang de la CGT, les deux organisations matricielles c’est-à-dire la CGT et la CFTC-CFDT ont engendré un mouvement progressif de fragmentation dont les derniers soubresauts datent des années 1990 et dont l’organisation qui nous accueille aujourd’hui est un des produits.
Le syndicalisme français, combien de divisions ? La plaisanterie est ancienne ; pourtant il y a eu du mouvement, une certaine tectonique des plaques pendant quelques décennies : les contacts CGT / FO étaient gelés mais la FEN faisait parfois le pont, la CFTC et FO avaient des contacts à l’ombre de l’hégémonique CGT ; et puis, la CFTC devenant CFDT, a noué une alliance du côté de la CGT.
Le pacte d’unité d’action conclu en janvier 1966 entre les deux confédérations a permis des luttes en commun dans les principales branches de l’industrie. Cette unité a donné confiance à la classe ouvrière, elle a permis les mobilisations importantes de 1966 et 1967 qui constituent les prémices des années 68.
En mai et juin de cette année-là, les deux centrales ont connu de fortes oppositions et d’autres encore lorsque la CGT a choisi de soutenir le programme commun des partis de gauche en 1972. Le débat était intense, les désaccords profonds auxquels il faut ajouter la question de l’URSS et des pays de l’est.
Et pourtant, les relations ont perduré, les confrontations aussi, il y a même eu un « débat idéologique » entre les deux centrales autour de l’autogestion, des libertés, des questions qui n’étaient pas mineures. Mais il restait un esprit unitaire, cette idée qu’il y avait « malgré tout » du commun parmi les divergences et que ceci devait primer. La rupture, ce sont les années 80 et même s’il y eut par la suite des moments de rapprochement, le fossé n’a cessé de s’agrandir. La tentative de syndicalisme rassemblé avancée par Louis Viannet au début des années 90 a fait long feu, la CFDT n’en voulait pas et la CGT l’a d’ailleurs abandonnée sans le dire en 2003 après le lâchage sur les retraites. La période Sarkozy les a vu faire cause commune mais depuis 2012, leurs relations relèvent de la guerre de tranchées.
Il faut dire que le nouveau système de reconnaissance de représentativité n’arrange pas les choses puisqu’il place les syndicats en perpétuelle compétition entre eux, la course à la première place apparaissant comme l’enjeu de la dispute, laquelle ressemble d’ailleurs à une dispute de cour d’école maternelle. Ruse de l’histoire, la réforme de 2008 qui l’instaura est le produit du seul véritable accord entre la CGT et la CFDT au cours des 20 dernières années !
La division syndicale a donc une longue histoire mais qui n’est pas homogène. L’utopie de l’unification générale des organisations avait cédé la place à une plus modeste ambition d’unité syndicale. Aujourd’hui, cette ambition a glissé elle-même au rang de l’utopie.
On a face à face deux blocs inconciliables, des visions du monde en tous points opposés, le seul point sur lequel les deux organisations sont d’accord, c’est pour dire qu’elles ne sont d’accord sur rien. Chacun est le repoussoir de l’autre, il y a même une sorte de connivence pour entretenir la profondeur du fossé.
L’existence de divergences importantes n’est pas le seul facteur car nous avons évoqué d’autres époques où les divergences n’étaient pas moindres mais où la recherche de l’unité semblait une valeur supérieure. C’est cela qui a été perdu, c’est au fond d’abord une affaire de volonté et cette volonté n’existe pas aujourd’hui.
Comment débloquer une telle situation ? je n’ai évidemment pas de réponse à cette question et d’ailleurs, ça n’est pas mon rôle. Mais on peut toujours suggérer, s’inspirer de de ce qui a produit des résultats dans d’autres domaines. Pourquoi ne pas réfléchir à une convention de citoyens-travailleurs, conçue selon les mêmes modalités que la convention citoyenne pour le climat (tirage au sort, pondéré ou non selon d’autres critères) avec une visée de redéfinition de ce qui serait nécessaire pour reconstruire un syndicalisme de masse ? Ce serait l’occasion d’impliquer largement au-delà des rangs syndicaux et des organisations figées dans leur jeu de rôle, créer un débat et un nouvel intérêt public sur un sujet largement délaissé par les médias. Une convention nationale, des conventions par régions ? A ceux qui craignent un affadissement des objectifs historiques du syndicalisme, on peut opposer la hardiesse des propositions formulées par la convention sur le climat. C’est un risque, il est moindre que celui de l’immobilisme.
Il se peut que la dure réalité fasse un retour en force : d’abord, si l’une ou l’autre des stratégies en présence était plus efficace que l’autre, cela aurait eu largement le temps de se voir. Mais surtout, l’ambiance, comment dire ? « glaçante », qui monte de ce pays pourrait bien forcer les unes et les autres à redécouvrir quelques communs syndicaux, par exemple autour de la défense des libertés. L’accès de l’extrême droite à la direction de régions importantes, le risque non négligeable qu’elle puisse même approcher voire décrocher la timbale en mai 2022 pourrait bien faire découvrir l’urgence d’une volonté de rapprochement. Mais peut-être n’est-on pas obligé d’attendre de telles extrémités !
Je terminerai en félicitant la FSU et son institut de recherche de contribuer à poser ces questions, à croiser les regards, à croire aux vertus de la réflexion et du débat. Elle n’est pas la plus mal placée pour illustrer les vertus de la diversité et de libre confrontation. Qu’elle soit remerciée pour sa contribution, je pense que ce colloque montrera la fécondité de sa démarche.
