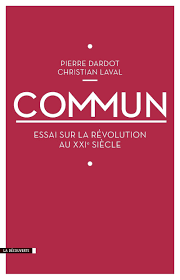 Christian Laval, Professeur de sociologie, vice-président de l’Institut de recherches de la FSU, co-auteur de Commun, Essai sur la révolution au XXIe siècle, La Découverte, 2014.
Christian Laval, Professeur de sociologie, vice-président de l’Institut de recherches de la FSU, co-auteur de Commun, Essai sur la révolution au XXIe siècle, La Découverte, 2014.
Il n’est pas sûr que le syndicalisme ait suffisamment réfléchi aux possibilités ouvertes par le numérique pour l’action collective. Nous ne voulons pas dire, avec les prophètes des réseaux comme Jeremy Rifkin, que tout ce qui a été construit depuis des décennies et des siècles va être emporté par le numérique, bien au contraire [2].
Maxime Leroy avait jadis montré comment le mouvement ouvrier avait inventé des institutions et un droit qui lui étaient propres [3]. Le syndicalisme en est l’héritier et cet héritage est précieux. Mais il n’y pas d’héritage vrai sans renouvellement. Et celui-ci s’impose pour de multiples raisons que nous avons analysées ailleurs [4].
Le mythe et les pratiques
Nous sommes bien conscients qu’Internet s’est transformé en un mythe bien utile, soit faussement révolutionnaire soit franchement réactionnaire. La révolution ne serait plus ce qu’elle a été, soit la transformation des rapports de domination et d’exploitation, puisqu’elle est déjà en cours grâce au réseau qui modifie et la politique et l’économie. L’hypothèse d’un communisme spontané qui naîtrait des connexions des multitudes ne tient pas. Elle ressemble plutôt à la version de gauche du « capitalisme connexionniste » pour reprendre la formule de Luc Boltanski et Ève Chiapello dans Le Nouvel esprit du capitalisme [5].
Loin du mythe, donc, il convient de partir d’un simple constat portant sur les pratiques quotidiennes de nos contemporains dans les pays économiquement avancés. Si nous savons que les déterminants du capital culturel et social jouent encore un rôle majeur dans les usages numériques, si nous sommes conscients de la « fracture numérique » entre classes sociales, il nous faut bien admettre cependant que, pour une grande partie de la population disposant d’un certain « capital de départ », l’accès au réseau transforme leur rapport au vaste tissu de données et de connaissances. L’information, la lecture de textes et de films, l’écoute de la radio et de la musique, la communication en général, ont été largement modifiées par la généralisation de l’usage d’ordinateurs individuels et de plus en plus par les téléphones mobiles. Près de 90 % de la population est connectée. Si l’âge est un critère déterminant de l’intensité de l’usage et de ses modes, il n’est plus et depuis longtemps une barrière. Nous ne lisons plus tout à fait de la même façon, nous ne regardons plus les films ou la télévision par les mêmes canaux et les mêmes écrans, nous n’écrivons pas non plus exactement comme nous le faisions avant. Mais surtout, nous nous transformons, chacun de nous, de façon plus ou moins sensible selon les cas, en co-opérateurs par la circulation des textes, des films et des idées mais également, par leur discussion collective, voire par leur élaboration. Nous transférons les textes ou les vidéos sur des listes, nous les « partageons » avec nos « amis » sur les réseaux, nous les « likons », nous ajoutons un commentaire souvent lapidaire, mais parfois substantiel. Il nous arrive aussi de faire circuler des « brouillons » de textes ou des images à nos amis proches, de leur demander des avis, des corrections, des suppléments. Non seulement, nous extrayons désormais beaucoup plus de « données » de ces échanges mais nous jouons un rôle plus actif dans leur circulation et leur production. Bref, nous sommes devenus ce qu’un récent rappport du CESE rédigé par Gérard Aschiéri et Agnès Popelin appelait des « socionautes » [6].
Évidemment, comme le rappelle ce même rapport, il convient de se méfier de tous les discours qui prétendent à l’unification ou à l’homogénéisation des savoirs, des goûts, des jugements grâce à la réalisation supposée du « grand village » mondial. Aucune des divisions de la société en termes socio-économiques, culturels ou politiques, n’est abolie par les moyens techniques. Et surtout, il convient de se défier des « illusions du consensus », dont un Mark Zuckerberg est le représentant le plus connu, qui voudraient que règne grâce à ces réseaux une bienveillance généralisée entre « amis ». Aucun réseau n’a supprimé calomnie, rumeur, mensonge et propagande. On peut même dire que ces antiques vices ont trouvé là un moyen idéal de se répandre à grande vitesse.
Mais cela ne valide pas non plus le déni, que l’on entend trop souvent, qui voudrait que rien n’a fondamentalement changé. Ce qui a changé, entre autres choses, c’est que l’on dispose désormais de nouveaux moyens de « faire ensemble », de partager et de produire en commun. C’est particulièrement le cas dans les pratiques de recherche et, plus généralement dans le travail intellectuel. Une véritable culture du partage, propre à « la science ouverte », s’est en effet développée et étendue, qui vient percuter les tendances contraires à la clôture marchande de la recherche. Des “communs intellectuels” se sont multipliés autour des revues en ligne, des banques de données et des blogs, rendant extrêmement facile la consultation des articles et des ouvrages récents des chercheurs du monde entier. Les grandes bibliothèques ont développé des programmes de numérisation d’ouvrages anciens et de documents de toute nature, ce qui donne accès aux supports de savoir dans toutes les disciplines. En d’autres termes, le travail intellectuel ne peut plus aujourd’hui se concevoir hors des réseaux et des banques de documents numériques.
L’enjeu social et politique du numérique
Le capitalisme a déjà largement opéré son virage numérique et ceci a des conséquences majeures sur l’économie et sur nos vies. Le « net » n’est plus l’espace neutre qu’il voulait être en ses débuts. La logique commerciale a envahi son espace, les cookies colonisent les messageries, les algorithmes permettent de « cibler » chacun pour optimiser la publicité. Les entreprises de pointe en matière de « management digital » ont bien compris qu’elles disposaient avec les sites, les forums et les blogs de moyens d’une très grande efficacité pour constituer des réseaux de clientèle et accumuler des données sur les clients, elles ont même réalisé qu’elles pouvaient construire des « communautés virtuelles » de collaborateurs bénévoles auxquels elles demandent des avis sur les prestations et les produits, des idées nouvelles ou des solutions techniques. En somme, elles ont développé des stratégies commerciales et productives visant à transformer leurs clients en « usagers collaboratifs ». C’est ainsi que le capitalisme digital a pris un essor extrêmement rapide par l’exploitation du vaste gisement d’informations que les usagers des réseaux communiquent lors de chacune de leur connexion. Une « économie de plateforme » s’est également développée, par le biais de sites et applications qui proposent de nouvelles façons de se déplacer, de faire du tourisme, de consommer ou de financer des projets. Nombre d’entreprises de services se « dématérialisent » avec une explosion de la fréquentation des sites des banques et des assurances et des mutuelles à partir desquelles on peut s’informer ou faire des opérations financières. En d’autres termes, le capitalisme immatériel, étroitement lié à la financiarisation de nos existences, est en train de développer des formes d’intelligence collective parfaitement adaptées à l’objectif d’accumulation du capital.
Mais d’un autre côté, et ce n’est pas la même chose, une autre logique se développe, un autre mode d’intelligence collective se déploie. Les réseaux favorisent l’engagement par la pétition et la discussion, ils permettent le développement d’un espace numérique oppositionnel dans lequel les agents manifestent une capacité collective à la critique de la logique même du système de production dominant sur les réseaux. Plus fondamentalement, les pratiques coopératives soutiennent aujourd’hui un nouveau discours, à portée révolutionnaire, qui se réclame du commun. Il y en a plusieurs conceptions. Mais ce qu’elles ont en commun, si l’on peut dire, c’est d’insister sur la formation d’une intelligence collective par la coopération des agents sur une base volontaire. Ce n’est pas tant la technique qui est ici déterminante que les pratiques de mise en commun réglée par des chartes acceptées par tous les coopérateurs (« commoners »). Le prototype de ce type de co-production de dimension mondiale est l’encyclopédie Wikipedia. Ces pratiques de « co-production » et de co-élaboration » ont non seulement un effet d’exemplarité – elles démontrent qu’il est possible de produire en dehors du marché – mais aussi un effet d’éducation, de formation, de resubjectivation. Nous nous formons à la coopération, nous en apprenons les règles, nous nous méfions de ce qui lui nuit, nous devenons subjectivement des coopérateurs qui prennent ainsi conscience dans l’activité commune de leur potentielle autonomie collective au regard des gigantesques moyens économiques, politiques et « informationnelles » dont dispose le capitalisme pour entretenir son hégémonie idéologique et sa domination matérielle.
Ce n’est donc pas étonnant que les mobilisations de ces dernières années ont puissamment sollicitées pour se construire les outils d’interconnexion, ordinateurs ou téléphones, contournant les médias traditionnels, affaiblissant leur fonction de filtre et de censure. Chaque mouvement social peut disposer de ses propres outils, blogs, forums de discussion, vidéos, etc, et jouer sur une certaine viralité des contenus élaborés au cours de leurs moments les plus créatifs. Mais surtout chaque mouvement social peut aller au-delà de la seule résistance ou réaction en construisant des « contre-espaces de l’intérieur », des « communs » d’information et d’échange, qui redoublent sans les remplacer les formes de co-présence dans l’espace réel, sous la forme par exemple de « l’occupation des places ». Ce qui caractérise ces mouvements, c’est la promotion de l’horizontalité et de la « participation » présentées comme des formes alternatives de société. La numérisation des mouvements sociaux est à la fois l’effet et la cause d’une mise en question de la démocratie réduite à une « représentation ». Elle contribue à l’exigence d’une réinvention de la démocratie selon des modes de co-participation et de co-élaboration.
A quand le virage numérique du syndicalisme ?
Les conséquences pour le syndicalisme ne peuvent être seulement techniques. Il ne s’agit pas uniquement de pouvoir diffuser plus rapidement et plus largement l’information, les analyses, les orientations, selon un modèle inchangé, à savoir pyramidal. Les directions élues, aussi bien d’ailleurs au niveau local que national, ne peuvent se contenter de « joindre » plus vite et « en un clic » tous les adhérents, elles ne peuvent en user seulement comme d’un moyen d’envoyer des communiqués et des consignes, selon le modèle « descendant » adopté par de nombreux organismes et associations qui « déposent » dans les messageries des adhérents leur newsletter. Cela économise du papier, sans doute, mais cela ne change pas fondamentalement le mode de relation entre « base » et « sommet ». Or nous sommes entrés, sans que le syndicalisme n’y fasse assez attention, dans une nouvelle phase historique dans laquelle les modes d’engagement mais aussi les formes d’élaboration du savoir et de la pensée connaissent des transformations majeures quoique contradictoires. En un mot, si les formes de la démocratie sont en train de changer, le syndicalisme doit y prendre sa part et sa place.
Le rapport du CESE, déjà cité, préconisait de « soutenir l’usage des réseaux sociaux comme outils de la participation citoyenne » et précisait qu’il serait bon de « développer les démarches participatives en favorisant l’acculturation numérique des élu.e.s et des fonctionnaires ». Le rapport faisait aussi le constat qu’« ils offrent de nouvelles opportunités de faire lien entre collectivités et habitant.e.s en valorisant l’expertise des usager.ère.s, et d’être les lieux dématérialisés d’échange, de partage et de co-élaboration ». Pourquoi ce type de recommandation valable dans le domaine du gouvernement des territoires ne le serait-il pas dans le monde syndical ? Et si ce mode de participation se développait dans le syndicalisme, pourquoi ne serait-ce pas aussi un levier pour réactualiser les idéaux d’autogouvernement des lieux de production et de travail, c’est-à-dire de revivifier l’exigence de la « démocratie du travail » ? Voilà des questions qui devraient être au cœur de l’activité syndicale, au centre des moments de formation, dans toutes leurs dimensions politiques et organisationnelles. Car comme nous l’avons laissé entendre plus haut, c’est la nature même des relations internes entre adhérents et responsables qui devrait être questionnée, c’est toute la signification de la « représentation » qui est à repenser, ce sont les modalités de la participation à reconsidérer. Le syndicalisme est-il en mesure de se poser à lui-même ces questions dans toute leur ampleur ?
Le rôle de l’institut de recherches de la FSU
Un institut de recherche, comme celui de la FSU, est un lieu et un outil d’autoréflexivité pour le syndicalisme. Il ne se substitue pas aux instances élues d’une organisation syndicale, bien sûr, mais il peut faciliter le questionnement de ces instances. Et d’abord par l’exemple. Car il est conçu comme un laboratoire d’idées et de pratiques. C’est d’ailleurs, ce qu’il fait déjà si l’on pense aux nombreux travaux qu’il a menés, et dont l’écho a souvent dépassé le seul cadre syndical. Pourtant, il est un domaine où il est resté relativement en retard, et c’est précisément celui du numérique. Certes, il dispose d’un site, d’une lettre d’information, et récemment d’une page facebook. Mais on doit se demander s’il ne devrait pas aller rapidement beaucoup plus loin dans cette voie, notamment en ce qui concerne la communication numérisée de ses publications et travaux. L’Institut publie une revue louée pour ses qualités aussi bien de contenu que de forme. Depuis sa relance, en 1998 avec Nouveaux regards, ancêtre de Regards croisés, sa diffusion a toujours été un problème, jamais résolu. Le nombre d’abonnés et de ventes à l’exemplaire est nettement insuffisant au regard de la qualité et de l’intérêt de ses articles de fond. La collection de près de vingt années est un véritable trésor. Or pas plus les articles récents que les anciens ne sont accessibles par voie numérique. L’institut en est resté à un schéma antérieur à celui du virage numérique, bien en arrière de ce qui se pratique maintenant dans la plupart des laboratoires universitaires et de recherche, où ont été mis en place des outils de « l’open source » et de « l’open data ». Ce schéma ancien est celui, paradoxalement pour un syndicat, du modèle payant, à une époque où circulent gratuitement des masses de documents et d’articles. Certes, il y a toujours place pour une revue papier de belle facture et de livres, qui facilitent la lecture ; certes l’idée de la disparition de la forme papier, nécessairement payante pour couvrir les coûts d’impression, est absurde et démentie tous les jours. Mais rien n’empêche l’Institut, qui n’est évidemment pas un organisme commercial, et tout le presse au contraire de mettre en place la diffusion gratuite de ses travaux et publications, de mettre à la disposition de tous, syndiqués et non syndiqués, son trésor d’archives et sa revue sous une forme numérique.
Il a tout à y gagner. Songeons encore une fois aux pratiques qui sont celles des chercheurs, des adhérents et des militants. Par les moteurs de recherche, des milliers de gens pourront à l’occasion d’une navigation « tomber » sur le site et donc sur l’Institut, partager avec leurs « amis » la découverte qu’ils auront faite, et réaliser tout ce travail de pollinisation que les membres de l’Institut ne sont pas en mesure de faire par eux-mêmes. Gageons que par ce moyen beaucoup de syndiqués de la FSU, parmi bien d’autre personnes, prendront connaissance de l’existence et des recherches de l’Institut. À vrai dire, l’Institut ne ferait que suivre la voie d’autres centres de recherche comme l’Institut d’histoire sociale de la CGT, qui a laissé en accès libre les principaux dossiers des Cahiers d’histoire sociale [7]. On peut également songer à la revue des chercheurs de la FSU, la Vie de la recherche scientifique (VRS), téléchargeable gratuitement. Dans notre esprit, l’installation de ce modèle non payant est inséparable de la contribution de l’Institut de recherche au questionnement sur les nouvelles formes démocratiques de l’action collective. Seul un engagement décidé dans le monde socio numérique fera que les pratiques elles-mêmes inviteront à réfléchir plus généralement aux effets des nouvelles technologies sur l’activité syndicale. Quittons les schémas désuets. Pas de continuité du syndicalisme sans son renouvellement.
[1] Jeremy Rifkin, La nouvelle société du coût marginal zéro : L’internet des objets, l’émergence des communaux collaboratifs et l’éclipse du capitalisme, Babel, 2016.
[2] Jeremy Rifkin, La nouvelle société du coût marginal zéro : L’internet des objets, l’émergence des communaux collaboratifs et l’éclipse du capitalisme, Babel, 2016.
[3] Maxime Leroy, La coutume ouvrière, Syndicats, bourses, fédérations professionnelles, coopératives, Doctrines et institutions, 2 volumes, (1913) , Editions CNT-RP, 2007.
[4] Louis-Marie Barnier, Jean-Marie Canu, Christian Laval, Francis Vergne, Demain le syndicalisme, Repenser l’action collective à l’époque néolibérale, Collection comprendre et agir, Syllepses, 2016.
[5] Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le Nouvel esprit du capitalisme, « Tel » Gallimard, 2009.
[6] Gérard Aschieri et Agnès Popelin, Réseaux sociaux numériques : comment renforcer l’engagement citoyen ? janvier 2017, http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2017/2017_01_réseauxsociaux.pdf
